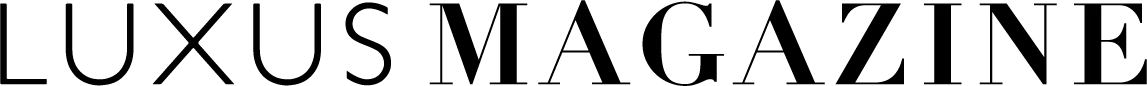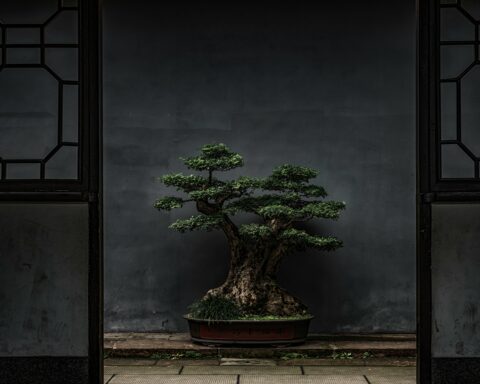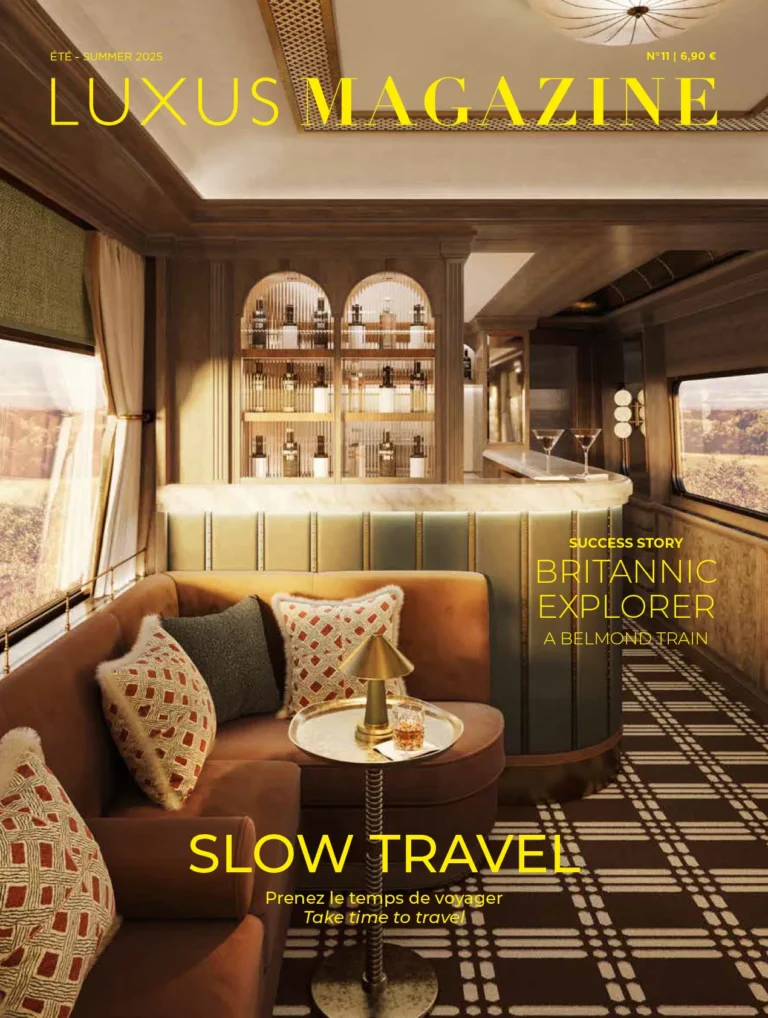A l’heure où le soleil darde ses derniers rayons estivaux et où certains peuvent encore se prévaloir de leur peau dorée de retour au bureau, voici une plongée dans la petite histoire du bronzage. Loin d’être un geste anodin, se dorer la pilule sur son lieu de villégiature est autant un acte social que statutaire. La pratique devenue socialement acceptable en Occident est passé d’une connotation paysanne au mythe doré de la modernité.
« Le bronzage est une invention culturelle du XXᵉ siècle », rappelle l’historien Pascal Ory dans son essai L’invention du bronzage devenu référence. Longtemps associé au labeur et à l’infériorité sociale, le bronzage est devenu au XXᵉ siècle un symbole de liberté, de modernité et de loisirs. Des dieux solaires de l’Égypte aux plages de Saint-Tropez, des aristocrates poudrés aux stars hollywoodiennes, l’évolution de la peau hâlée illustre un basculement culturel majeur. Derrière l’apparente légèreté estivale, il révèle des enjeux sociaux, politiques et esthétiques, éclairant nos rapports au corps, au pouvoir et au désir.
Le soleil, entre divinité et danger dans l’Antiquité
Dans les civilisations anciennes, le soleil n’était pas seulement source de lumière, mais d’abord une divinité. En Égypte, Rê – le Dieu-Soleil – incarnait la puissance vitale et les pharaons, représentés avec une peau dorée, associaient ce teint lumineux à la prospérité. Ce hâle n’était pas un bronzage volontaire, mais un symbole religieux.

Chez les Grecs et les Romains, l’idéal restait paradoxal : les dieux comme Apollon étaient dorés et rayonnants, mais les élites valorisaient les peaux claires, protégées du soleil grâce à des voiles ou des onguents. L’historien Jean-Claude Bologne rappelle que, pour les patriciens romains, « le teint pâle signifiait l’oisiveté, la disponibilité au loisir cultivé, par opposition au hâle des esclaves et des soldats ».
Moyen Âge et Renaissance : la blancheur aristocratique
Durant le Moyen Âge et la Renaissance en Europe, la blancheur devint un signe de noblesse et de distinction. Les femmes utilisaient poudres, fards ou ombrelles pour se préserver des rayons. Christine de Pizan – considérée comme la première intellectuelle féministe de l’Europe moderne – écrivait au XIV siècle que « la blancheur du teint est miroir de pureté et d’éminence ».

La peau bronzée restait associée au labeur des travailleurs, comme les agriculteurs ou les marins. Dans les cours italiennes, Sandro Botticelli ou Bronzino peignaient les maîtresses princières avec une carnation diaphane, symbole suprême de beauté féminine.

Cette hiérarchie du teint n’était pas propre à l’Occident : en Chine, au Japon ou en Inde, la blancheur restait synonyme de raffinement. Des siècles plus tard, cette logique perdure encore avec des crèmes éclaircissantes vendues à des millions d’exemplaires.
Le tournant hygiéniste : le soleil comme remède
C’est au début du XXᵉ siècle que tout bascule en Occident. La médecine hygiéniste découvre les vertus thérapeutiques du soleil, présenté comme remède contre la tuberculose, l’anémie ou le rachitisme. Les sanatoriums s’ouvrent dans les Alpes ou sur les côtes françaises pour offrir aux malades l’air pur et la lumière.

L’urbanisme s’en inspire : Le Corbusier et Jeanneret intègrent lumière et larges baies vitrées dans leurs constructions. Les écoles et cités-jardins sont pensées pour « élever des enfants en bonne santé », exposés au soleil.
Les années 1920 : l’invention culturelle du bronzage
À partir de 1920, le bronzage se démocratise comme geste moderne. Le terme apparaît dans le magazine Marie Claire, ancêtre d’Elle. Henri de Montherlant, dans Les Olympiques (1924), écrit qu’ « au bronzage des genoux qui cesse net, on voit que ça n’a jamais mis de pantalons ».

Deux légendes marquent cette période : Jean Patou, créateur de l’huile de Chaldée (1927), première huile bronzante de l’humanité, avec Suzanne Lenglen, championne de tennis, pour égérie, et Gabrielle Chanel, après une croisière sur la Côte d’Azur, revient à Paris avec un hâle doré immortalisé par les journaux de l’époque et d’un coup, le bronzage devient glamour, signe d’élégance et de liberté. « Le bronzage devient synonyme de santé, de dynamisme et de liberté », observe Pascal Ory.

Ce nouveau canon s’accompagne d’autres révolutions féminines : cheveux coupés, jupes raccourcies, droit de vote. Le corps féminin se dévoile et s’émancipe.
Les congés payés en France : démocratisation du soleil et explosion du marché des solaires
Le bronzage ne s’impose pas seulement comme un phénomène esthétique : il devient un marqueur social et politique. Dans les années 1930, les régimes totalitaires exploitent l’image du corps solaire : l’Allemagne nazie promeut l’athlète blond, bronzé, symbole de vigueur aryenne, tandis que l’Italie fasciste associe la peau dorée à l’énergie méditerranéenne.

En 1936 en France, l’avènement des congés payés (la même année, Jean Patou – encore lui – lance un parfum intitulé « Vacances » qui atteste bien de l’ampleur du mouvement du tourisme balnéaire), la généralisation des bains de mer et l’essor des auberges de jeunesse transforment le soleil en allié d’une nouvelle société des loisirs. Le culte du soleil se démocratise, devient un signe d’égalité sociale et un symbole de liberté, de modernité et de vacances au grand air, reléguant dans le passé l’idéal de peau pâle, autrefois prisé des élites. Désormais, ouvriers et bourgeois se côtoient sur les plages, « où tous, blancs ou hâlés, se confondent dans une même liesse ensoleillée », ironise Albert Londres, jeune journaliste français du début du XX siècle.

Le marché des crèmes solaires explose avec les marques comme L’Oréal (en 1935, Eugène Schueller, fondateur de L’Oréal, lance ses premières huiles solaires pour le visage et le corps, suivi en 1936 par le lancement de sa gamme Ambre Solaire), Lancaster ou Piz Buin, développant des produits toujours plus innovants : résistants à l’eau, enrichis en vitamines, plus sensoriels. La publicité et articles de presse relient santé et beauté : Marie Claire défend le bronzage comme idéal hygiéniste et esthétique et déclare que l’été 1939 sera placé sous le signe du maillot de bain deux-pièces.

Autres cultures, autres perceptions
En Asie, la peau claire demeure un idéal esthétique profondément enraciné dans des traditions confucéennes et bouddhistes, où blancheur rime avec noblesse, pureté et raffinement. Cet héritage perdure encore : dès l’enfance, la protection solaire s’impose dans les routines beauté en Chine, au Japon ou en Corée, via crèmes à SPF élevé, capelines, ombrelles, voiles, chapeaux à larges bords ou vêtements filtrants. La pâleur reste ainsi le canon dominant. Comme l’exprimait déjà l’écrivain japonais Jun’ichirō Tanizaki dans Éloge de l’ombre (1933) : « La pâleur de la peau révèle la délicatesse du corps et l’élégance de l’esprit. »
En Inde, une peau claire reste associée à la réussite sociale et matrimoniale. Le marché des crèmes éclaircissantes pèse des milliards.
Dans les pays du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord, la relation au soleil est plus ambivalente : quotidien, il est à la fois respecté, redouté et contourné via des pratiques traditionnelles – voiles, henné, huiles protectrices. Il est rarement associé à une quête esthétique de bronzage mais plutôt intégré aux rythmes de vie.
En Afrique ou en Polynésie, la peau sombre ou bronzée s’inscrit dans une identité naturelle et valorisée, sans l’opposition hiérarchique occidentale entre hâle et noblesse. Le bronzage comme pratique volontaire y apparaît donc comme une curiosité étrangère, importée par le tourisme.
De l’âge d’or aux dérives
L’après guerre, des années 1950 aux années 1970 marque l’âge d’or du bronzage. Hollywood amplifie la tendance : le teint caramel d’Ava Gardner, Elizabeth Taylor et Richard Burton ou encore Grace Kelly incarne le rêve californien. La publicité des années 1950 glorifie la crème solaire et les transats, au point que le bronzage devient presque un devoir culturel.

Quelques années plus tard, Brigitte Bardot et Jane Fonda sur la plage de Saint-Tropez ou Jane Birkin dans les années 1970 feront du hâle un idéal sensuel et libérateur.

Mais dès le milieu des années 1970, la crise économique résultant du premier choc pétrolier et les premières alertes médicales changent la donne. Le bronzage, jadis promesse de santé, est désormais associé à un risque : vieillissement cutané, mélanomes, taches pigmentaires. Les connaissances progressent et les gestes de protection se généralisent.
SPF, UVA, UVB : trois lettres qui ont changé notre rapport au soleil
L’envie de se protéger du soleil ne date pas d’hier. Déjà dans l’Antiquité, on utilisait argiles, riz ou huiles végétales pour apaiser et filtrer le rayonnement. Mais c’est au XXe siècle que tout change.

En 1938, le chimiste suisse Franz Greiter conçoit la Gletscher Crème après un coup de soleil en montagne et introduit le concept de SPF, acronyme pour – Sun Protection Factor, ou Facteur de Protection Solaire. La crème est considérée comme l’un des premiers écrans solaires modernes et Franz Greiter comme l’inventeur du SPF.

À noter que le chiffre indiqué à côté du SPF est le niveau de protection contre les rayons UVB (rayons ultraviolets aux longueurs d’onde moyennes), responsables des coups de soleil et de certaines formes de cancer. Un SPF 30, par exemple, signifie que la peau protégée mettra 30 fois plus de temps à brûler que sans protection. Cependant la différence entre les indices n’est pas linéaire. Un SPF 15 bloque 93 % des UVB, un SPF 30, 97 %, et un SPF 50, environ 98 %.
En 1978, la FDA reconnaît le SPF comme standard. Depuis, les normes se sont harmonisées à l’échelle internationale et le SPF s’est infiltré partout : crèmes de jour, fonds de teint, maquillage, sticks à lèvres, sprays capillaires, vêtements anti-UV notamment en Asie ou en Australie, où les tissus UPF (Ultraviolet Protection Factor) sont une barrière physique de plus en plus plébiscitée.
Depuis quelques années, la question des UVA (rayons ultraviolets aux longueurs d’onde les plus élevées), qui pénètrent plus profondément et accélèrent le vieillissement cutané et de certains cancers, a pris de l’ampleur. Les protections dites « à large spectre » ou portant un logo UVA offrent désormais une défense complète.

Si les filtres solaires protègent la peau, certains suscitent des débats. Des ingrédients comme l’oxybenzone ou l’octinoxate sont accusés de perturber le système endocrinien ou de nuire à la vie marine. Hawaï les a interdits pour protéger ses récifs coralliens. En réaction, les marques innovent : formules reef-friendly, filtres minéraux comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, textures clean, sans traces blanches.
Mais les idées reçues persistent : un SPF élevé ne dispense pas de ré applications. La crème solaire n’empêche pas de bronzer, mais permet un bronzage plus lent et plus durable. Les UV sont présents toute l’année, même par temps nuageux.
Le bronzage à l’ère des contradictions
Les années 1980 voient apparaître les cabines UV, symbole d’un bronzage artificiel à outrance, tandis que le nec plus ultra du bain de soleil se doit d’être sein nus, la mode topless devient l’incarnation des années fric et frime. En parallèle, les campagnes de prévention rappellent que « le bronzage est une brûlure » à l’image de la campagne « Slip, Slop, Slap » en Australie qui a prouvé son efficacité dans la lutte contre les cancers cutanés, axée sur une pédagogie simple, visuelle et répétée pour ancrer les bons gestes.

Aujourd’hui, Instagram et les stars (Paris Hilton ou Kim Kardashian, par exemple) relancent les débats sur l’appropriation culturelle et les normes esthétiques. À l’inverse, certaines célébrités comme Emma Watson, Cate Blanchett ou encore Pamela Anderson revendiquent la peau naturelle, refusant l’injonction solaire.
Le bronzage, miroir d’une société
« La peau devient un texte social que l’on lit et interprète », rappelle Pascal Ory. Tantôt stigmate paysan, tantôt privilège balnéaire, le bronzage raconte l’histoire d’une société en mutation : de la propagande fasciste des années 1930 à l’imaginaire Instagram, il est devenu marqueur de liberté, de plaisir et de réussite. Mais il reste ambivalent, partagé entre culte esthétique et vigilance médicale. Aujourd’hui, la culture éclatée du bronzage incarne cet “en même temps” : s’exposer et se protéger, accepter la coexistence des peaux hâlées et des teints pâles, tout en poursuivant une quête de soleil à la fois collective et intime : celle qui consiste à se protéger, à prendre soin de sa peau avec plaisir, et à continuer d’aimer le soleil… sans jamais s’y brûler.
À lire aussi > La petite histoire du… Monoï
Photo à la Une : Unsplash