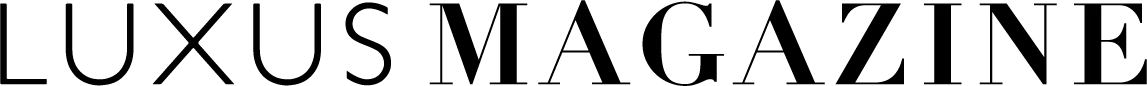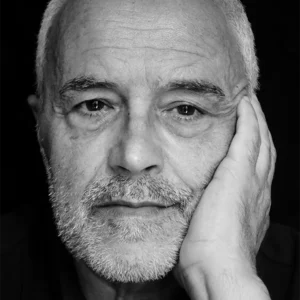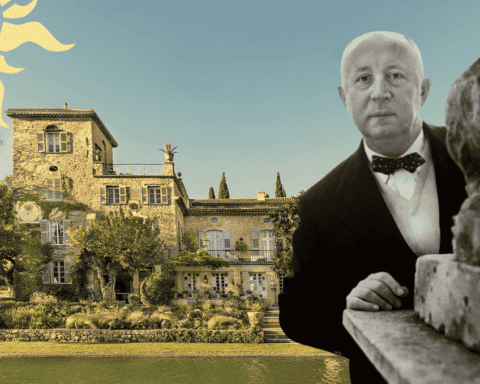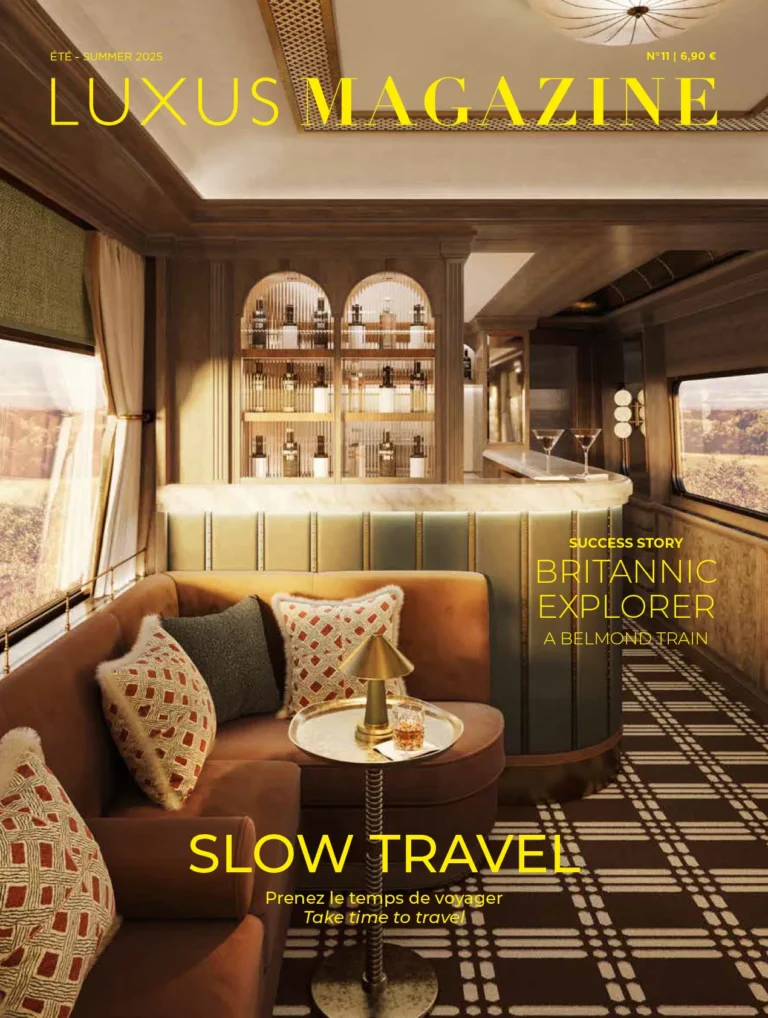Economiste et femme engagée, Linda Rama s’avère bien plus que l’épouse du premier ministre albanais Edi Rama. Pour Luxus Magazine, le journaliste Màrio de Castro l’a rencontré et vous propose un entretien exclusif.
Qui est Linda Rama, épouse du Premier ministre albanais Edi Rama ?
Linda est économiste et diplômée de l’université de Tirana depuis 1987. Elle a obtenu une maîtrise en économie à l’université centrale européenne (CEU) de New York en 1993. Elle est également titulaire d’un doctorat en économie. Elle a été chargée de cours en finance internationale et finance publique à l’université de Tirana et chargée de cours en politiques publiques et gestion des risques publics à l’université européenne de Tirana.
De 1993 à 1999, Linda Rama a été consultante pour l’Agence nationale de privatisation sous l’égide du Conseil des ministres et a siégé au conseil de surveillance du Centre d’enregistrement des actions, qui a précédé la création de la Bourse albanaise.
Linda est cofondatrice du Centre de promotion du développement humain (HDPC), l’un des premiers groupes de réflexion en Albanie. Elle est auteure, co-auteure et experte en recherche dans des domaines tels que la gouvernance, le développement humain, le marché du travail, l’éducation, la protection sociale et le développement du secteur privé en Albanie et dans les régions voisines.
Linda Rama est cofondatrice de l’Alliance albanaise pour les enfants et défenseure du mouvement « Say Yes For Children ». Elle est depuis longtemps engagée dans la défense des droits humains et de la société civile, en particulier ceux des enfants et des femmes.
Le secteur touristique albanais, en plein essor et durable, est le pays hôte officiel de l’ITB Berlin 2025. Le tourisme est un secteur en forte croissance. En 2024, 11,7 millions de visiteurs se sont rendus en Albanie. La majorité des investissements directs étrangers (IDE) provenaient de Turquie, suivie de l’Italie. Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), il y a cinq raisons d’investir en Albanie : un climat d’investissement libéral et réformiste, une situation géographique optimale, une croissance et une stabilité économiques, le développement d’infrastructures pour le tourisme haut de gamme, et une attention particulière portée au développement durable et à l’environnement. Les hôtels, les aéroports, les marinas, les centres d’art, les musées, les initiatives gouvernementales et l’amélioration des infrastructures… font partie des facteurs qui contribuent à la croissance record du tourisme.
Un littoral époustouflant, des sites historiques riches, une culture dynamique, une beauté naturelle et une hospitalité moderne… ainsi que des projets prometteurs pour l’avenir, mettent l’Albanie sur la voie de nouveaux records économiques et sociaux.
Interview
M de C : Vous considérez-vous comme une défenseuse des droits des femmes ?
Linda Rama : L’Albanie figure en tête du classement des Nations unies pour la représentation des femmes dans la politique et la société. Je considère que ma génération et moi-même, en tant que militantes de la société civile, sommes en mesure de lutter pour les droits des femmes et leur représentation. Nous ne le faisons pas dans notre propre intérêt. Je pense que notre première mission est de faire bouger les choses, car en tant que femmes, nous sommes censées faire bouger les choses, et il y a tant de choses que nous pouvons faire mieux que les hommes. Et faire bouger les choses, ce n’est pas seulement agir, c’est continuer à agir !
M de C : Pensez-vous que la lutte pour les droits des femmes est sans fin ?
Linda Rama : Pour remplir les fonctions ou le mandat qui vous sont confiés au sein du gouvernement, c’est au parlement que vous devez faire la différence. Par exemple, lorsque vous savez que quelque chose ne va pas dans une communauté, vous ne devez jamais vous résigner à l’accepter. Il faut mettre fin à ce statu quo. Nous élevons actuellement une nouvelle génération, complètement différente de la mienne, et nous devons donc nous adapter à ses besoins. Même si Edi m’a beaucoup soutenue – et je suis très reconnaissante envers lui et d’autres personnes qui sont conscientes de la nécessité d’accroître la représentation des femmes –, je n’ai pas l’impression que cela se produit, et je me sens parfois un peu frustrée.
M de C : En tant que femme née et élevée en Albanie, vous avez réussi la transition post-communiste. Quelle est votre vision de l’avenir des femmes en Albanie ?
Linda Rama : J’ai grandi avec une grand-mère qui travaillait à plein temps à la maison, qui investissait tout son talent, son intelligence et son autorité dans la famille sans jamais avoir la chance de s’épanouir en dehors de ces murs. Ma mère est la femme typique du réalisme socialiste.
Elle travaillait à l’usine et à la maison, sans jamais cesser de veiller à notre bien-être, en nous encourageant à faire des études et en nous inculquant le sens du travail et des responsabilités. La vie des femmes dans un État communiste était difficile et pénible, à tel point que toutes les femmes de cette époque méritaient d’être qualifiées de héroïnes.
Ma mère n’a exercé qu’un seul métier toute sa vie, celui que l’État avait choisi pour elle. Quand je la vois aujourd’hui, à plus de 80 ans, et que je constate comment elle parvient à tirer parti de tous les avantages offerts par la technologie en matière d’information, de communication et de solutions, je regrette qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se découvrir et d’exploiter tout son potentiel.
Cependant, ma mère a eu la chance de voir ses filles mieux éduquées qu’elle, exercer le métier qu’elles avaient choisi et non celui que l’État ou l’idéologie aurait choisi pour elles, et réussir à faire face à une transition extrêmement difficile à tous les égards.
En revanche, pour ma fille et mes deux nièces, l’éventail des droits dont elles bénéficient est sans précédent, tout comme celui des opportunités qui s’offrent à elles pour réaliser leurs rêves et vivre leurs passions. Ce que j’ai décrit très brièvement ci-dessus s’est développé dans des contextes très complexes et difficiles, avec des efforts considérables pour atteindre le monde civilisé tout en luttant quotidiennement contre notre passé ottoman-communiste compliqué.
Aujourd’hui, il y a encore des filles et des femmes qui se débattent dans les griffes de ce passé, tout comme il existe une immense armée de filles et de femmes engagées dans l’éducation, la santé, les services sociaux, la justice, les arts et la culture, et jusqu’aux plus hauts niveaux de l’administration publique, de la gouvernance et de l’élaboration des politiques. Les progrès évidents et la grande puissance de cette armée me font croire que toutes les filles et toutes les femmes de demain auront franchi le seuil de la soumission et seront capables de vivre la vie qu’elles auront choisie et non celle qui leur aura été imposée. Cependant, aucune vision de l’avenir des femmes ne peut être dissociée de celle des garçons. Le moment est venu de parler de manière égale de l’avenir des filles et des garçons.

M de C : Vous partagez votre vie avec Edi Rama, le Premier ministre, qui, outre ses responsabilités politiques, est également artiste. Comment se déroule cette vie pour vous ?
Linda Rama : Vous êtes-vous déjà demandé comment un Premier ministre qui est également artiste peut composer avec une femme qui est professeure et chercheuse en politiques publiques, mais aussi militante civile ? Pour répondre à votre question, je dirais que les responsabilités politiques d’Edi en tant que Premier ministre de l’Albanie nous empêchent de nous concentrer uniquement sur nos capacités à composer l’un avec l’autre, mais nous poussent à essayer de rendre chaque minute d’Edi utile à sa vision transformatrice pour l’Albanie. Est-ce difficile ? Oui, c’est difficile.
M de C : Alors que tous les regards sont tournés vers l’Albanie, quels sont les talents émergents albanais dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique, de la littérature, du théâtre, de l’opéra, de l’architecture et d’autres formes d’expression créative ?
Linda Rama : Il suffit de suivre le parcours brillant des artistes albanais à travers le monde pour se rendre compte du potentiel et de la capacité créative de ce petit pays. Il y a Ismail Kadare, Ibrahim Kodra, Ermonela Jaho, Tedi Papavrami, Angjelin Preljocaj, Dua Lipa, Anri Sala, Ermal Meta, Rita Ora, Sajmir Pirgu, Nensi Dojaka, Fadil Berisha, Luiza Gega, les garçons de l’équipe nationale de football à l’Euro 2024 ou Mira Murati, qui, ces dernières années, a atteint les sommets de la créativité technologique. Les histoires de ces personnes sont aussi extraordinaires que leur talent et leurs réalisations sont des exemples qui montrent que rien n’est impossible pour les rêveurs qui sont déterminés à réaliser leurs rêves.
M de C : L’UE serait le plus grand fournisseur d’aide financière à l’Albanie. Est-ce exact ?
Linda Rama : C’est tout à fait vrai en termes de financement, et je pense que pour l’Europe, cette aide est très importante pour ses propres politiques. On ne peut pas attendre que des pays comme le nôtre survivent par leurs propres moyens. C’est impossible ! L’une des dernières études que j’ai réalisées, publiée il y a quelques mois, est une analyse très approfondie des réglementations fiscales et de la manière de faire face aux objectifs de développement : où trouver des ressources, où se trouvent les ressources que nous pouvons utiliser.
Cette étude montre clairement que nos ambitions sont bien supérieures à nos possibilités et que la plupart des ressources ne sont actuellement pas à la portée du financement de l’Union européenne ou des gouvernements, car les réglementations fiscales sont très strictes. Même si nous améliorions l’efficacité, quel que soit le montant obtenu, il s’agirait d’un faible pourcentage de l’aide officielle actuelle, car celle-ci est aujourd’hui destinée aux capitaux privés, étrangers et nationaux.
Mobiliser des capitaux privés étrangers n’est pas si facile, bien sûr, ils partagent le même objectif, mais ce n’est pas facile et je pense que l’une des choses fantastiques qu’Edi a faites depuis le tout début est de mobiliser – comme dans l’architecture, par exemple – pour trouver de nouveaux moyens de surmonter les bureaucraties qui tuent les investissements et de rendre le pays attractif du point de vue des investisseurs.
Les investissements importants qui ont été réalisés dans le tourisme, comme ces projets architecturaux bien connus, sont pour la plupart stratégiques. Ils sont classés comme investissements stratégiques. Cela permet de gagner du temps, de mobiliser et de faciliter les procédures pour que les investissements portent leurs fruits. Mais les ressources sont clairement bien inférieures à ce dont nous avons besoin, et l’Europe devrait donc être un contributeur majeur. Bien sûr, cela dépend de notre capacité à les absorber !

M de C : Après la fin de la dictature albanaise en 1991, à quel moment avez-vous commencé à vous engager auprès de l’Union européenne ?
Linda Rama : Si je ne me trompe pas, mon premier véritable contact avec l’Europe remonte à 1996. J’avais été invitée à une grande réunion avec ce groupe de réflexion financière sur la transformation de l’unité monétaire européenne (ECU). Nous étions dans une grande salle en Hongrie, et je me souviens à quel point les discussions étaient passionnées et brillantes, c’était l’idéalisme à l’œuvre. Je ne retrouve pas cela aujourd’hui. Parce que les générations ont changé. Mais je pense que l’Europe doit continuer, car elle est très importante pour nous. Ce ne sont pas nos institutions qui contrôlent nos progrès en matière de normes et d’avancées à réaliser. Leur contrôle est très professionnel, et nous savons ce qui manque. Si vous consultez les rapports d’avancement, vous verrez ce que nous avons fait chaque année depuis 2007 pour franchir chaque étape, et c’est très important pour nous.
M de C : Pouvez-vous m’en dire plus sur votre Centre de promotion du développement humain (HDPC) ?
Linda Rama : J’ai cofondé le HDPC avec un collègue qui est malheureusement décédé il y a deux ans. De mars 1999 à décembre 1999, j’ai travaillé pour le gouvernement. Je dirigeais l’agence de privatisation sous l’égide du Conseil des ministres, alors présidé par le Premier ministre. Puis, en décembre 1999, le nouveau Premier ministre qui a été nommé a décidé de ne pas travailler avec moi et m’a écartée de l’agence. J’étais une technicienne, pas une politicienne. J’étais très jeune, j’avais 34 ans à l’époque, et je dirigeais l’agence la plus importante du pays, chargée des réformes les plus importantes.
M de C : En tant que femme et économiste dans une Albanie post-dictature, quels défis avez-vous rencontrés ?
Linda Rama : J’ai une formation en économie, mais j’ai été la première à partir à l’étranger et à revenir en 1993 avec un master dans mon domaine, j’étais donc pleine d’espoir. Je savais ce que j’avais à faire : rattraper les pays du bloc de l’Est comme la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, qui avaient une longueur d’avance en matière de réformes, notamment parce que leur passé était complètement différent du nôtre. Ils disposaient d’institutions avant d’entrer dans le bloc, comme des institutions de marché, et n’étaient jamais allés aussi loin que nous dans le contrôle total de l’État, sans aucune entité privée. Ils avaient bien sûr plus d’avantages, mais j’ai très vite compris que tout reposait sur la rapidité et la qualité des réformes qui devaient en même temps répondre à des objectifs multidimensionnels qui étaient beaucoup plus présents en Albanie que dans d’autres pays. Mais nous devions rattraper notre retard.

M de C : Le mot « privatisation » a-t-il commencé à apparaître en Albanie au début des années 1990 ?
Linda Rama : Quand je suis revenue, je savais que je dirigeais un vaste mouvement de privatisation, une privatisation stratégique, dans le cadre de ma fonction consistant à mettre en place le cadre juridique et réglementaire. Se posait également la question de la mise en œuvre. J’ai commencé à comprendre que la politique était très compliquée. Nous partagions le même programme avec les techniciens, la même vitesse et les mêmes connaissances. Pour simplifier, je pense que les gens suivaient des chemins différents, sans savoir quoi faire ni comment s’y prendre. Gagner était également un aspect très important. Ils voulaient de plus en plus travailler avec « leurs gens », et je n’étais pas l’une d’entre eux.
M de C : Avez-vous trouvé votre voie dans la politique au début de la transformation économique de l’Albanie ?
Linda Rama : Oui, mais j’ai survécu à trois Premiers ministres au cours de ce parcours. Aleksandër Meksi, du Parti démocratique, est celui qui est resté le plus longtemps après Edi. Il a été élu en 1992 et est resté au pouvoir jusqu’en 1996.
Il a également été élu pour un second mandat, mais 1997 a tout changé, avec les systèmes pyramidaux, l’effondrement financier, et je travaillais avec le gouvernement qui devait rétablir la normalité dans le pays. L’autre Premier ministre était Fatos Nano, le leader du Parti socialiste. Donc, trois Premiers ministres. Edi est le quatrième.
La pression politique était forte et la privatisation était une réforme très politique. Puis, en 1999, j’ai participé à un projet en Pologne avec Leszek Balcerowicz et sa femme Ewa Balcerowicz. Balcerowicz était alors ministre des Finances en Pologne, et je crois aussi vice-Premier ministre, et ils avaient une fondation, CASE, qui était un centre d’études économiques et sociales, connu pour réunir des experts de différents pays. Je participais à un projet avec eux à l’époque, j’enseignais à l’université, en finance, en finance internationale, et je faisais également de la recherche. Il était professeur à l’université de Stanford, j’avais donc certains engagements dans différents projets à l’étranger.
Mon intention était vraiment de voir ce qui se passait à tout moment, et j’ai également été l’un des premiers contributeurs au Project Syndicate de 1995 à 1997, une plateforme très connue ici, et j’ai été l’une des quatre premières personnes, grâce à mon travail à l’université.

M de C : Comment restez-vous concentré sur vos objectifs à long terme ?
Linda Rama : C’est une question très intéressante. Comme vous le savez, j’ai commencé dans la recherche économique, puis j’ai quitté le gouvernement et j’ai compris dès le début que l’approfondissement de l’économie n’était pas fait pour moi, car on pouvait devenir très théorique, et clairement, à l’époque, ce n’était pas notre intention. On ne pouvait pas être utile en se contentant d’approfondir la théorie ! J’étais une femme et j’avais des enfants à élever. À l’époque, Rea avait huit ans, et je me souviens m’être dit : « Si je n’ai pas la force d’affronter ce dilemme entre vie professionnelle et vie privée, qu’en est-il de toutes les femmes dans le monde qui ne sont pas dans ma situation, qui n’ont pas la chance d’avoir fait des études, qui ne sont pas combatives, indépendantes et libres ? » Mon père m’a élevée, même pendant le communisme, dans un esprit de liberté, et je lui en suis très reconnaissante. Je me suis demandé ce qui se passait. J’ai donc décidé que ma première mission ne serait pas de mettre de côté la question économique en Albanie, mais de m’y intéresser. Ma deuxième mission était de comprendre les liens entre l’économie, l’expérience humaine et les défis sociaux.
Les questions relatives aux droits de l’homme m’intéressent beaucoup, car je viens d’un pays communiste où nous n’avions aucun droit.
M de C : Qu’est-ce qui explique l’engouement actuel pour l’Albanie, qui ne se limite pas à l’Europe mais s’étend au monde entier ?
Linda Rama : Au cours de ces 35 années de transition, nous, Albanais, avons réussi à relever deux défis historiques : ouvrir les portes du monde à notre pays et faire entrer le monde chez nous.
La première étape a commencé en juillet 1990, lorsque des milliers d’Albanais ont envahi les cours des ambassades à Tirana et embarqué sur des bateaux à Durrës pour échapper à l’isolement communiste et à la pauvreté. Puis, pendant de nombreuses années, des dizaines de milliers d’autres Albanais ont pris chaque année le chemin des montagnes, de la mer et des airs, impatients de vivre le rêve européen ou américain. Au prix d’énormes efforts, ils ont réussi à obtenir le droit de citoyenneté dans les pays où ils avaient choisi de vivre, en surmontant des montagnes et des mers de préjugés.
En théorie, en 1990, avec la chute de l’isolement communiste, l’Albanie a également ouvert ses portes au monde. Les premières à arriver ont été les institutions internationales étrangères, suivies de quelques étrangers venus travailler. Pendant plus d’un quart de siècle, les seuls touristes en Albanie étaient les Albanais émigrés qui rendaient visite à leur famille ou les Albanais de la région. Je me souviens d’une conversation avec des collègues vers 2008. Inquiets que le monde ne nous connaisse pratiquement pas et que, lorsque nous étions mentionnés dans les médias internationaux, c’était à cause de quelques méfaits commis ici et là à la frontière, nous essayions de trouver un moyen de changer cette image. Nous avons discuté longuement jusqu’à ce qu’un de mes collègues dise : « N’essayez pas de trouver une solution, l’image de l’Albanie changera lorsque l’Albanie changera. »

L’Albanie a changé. Aujourd’hui, l’Albanie est une destination touristique, commercialisable et où il fait bon vivre. La vague croissante de sympathie et d’intérêt pour l’Albanie en Europe et dans le monde s’explique par le fait que l’Albanie offre aujourd’hui nature, histoire, culture, services, sports, divertissements, confort, aventure, infrastructures, architecture, travail et sécurité. En Albanie, vous êtes en sécurité partout et vous n’avez aucune raison de vous sentir en danger. Amener le monde à la porte de l’Albanie et faire connaître l’Albanie dans le monde a été, je crois, le parcours de transition le plus inimaginable, le plus difficile et le plus douloureux, qui a également marqué la fin de l’isolement communiste extrême. Il y a encore dix ans, nous étions au mieux un potentiel, aujourd’hui nous sommes une réalité touristique avec un potentiel encore largement inexploité. Ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie est le résultat tangible de la vision de développement des dirigeants politiques et du travail extraordinaire accompli par les Albanais en Albanie et par les Albanais du monde entier, là où ils vivent et travaillent depuis trois décennies, après la chute du communisme.
M de C : Vous êtes une femme très attentionnée, proche des groupes les plus vulnérables de la société. Quelles sont vos motivations et vos attentes ?
Linda Rama : Je crois que la façon dont nous pensons, nous comportons et agissons face à la vulnérabilité nous définit en tant qu’individus et en tant que société. En Albanie, la structure sociale héritée du communisme et la transition plutôt difficile des trois dernières décennies ont créé des vulnérabilités que même les États les plus puissants économiquement auraient du mal à résoudre en temps réel. De plus, au fil des ans, j’ai compris de plus en plus qu’il existe une perception selon laquelle, dans la société, le terme « vulnérabilité » renvoie au terme « pauvreté », divisant ainsi la société entre « nous » et « eux ». Il est vrai que la pauvreté est une vulnérabilité, une grande vulnérabilité. Parfois, et malheureusement, ce type de vulnérabilité se transmet également de génération en génération. Mais je pense aussi que la vulnérabilité n’est pas l’apanage des pauvres, d’autant plus à l’époque où nous vivons, où personne n’est à l’abri du risque d’être vulnérable. Il est donc dans l’intérêt de tous de cultiver une empathie et une solidarité particulières envers les groupes vulnérables. Je garde également l’espoir que l’État albanais et sa société garantiront que la prochaine génération d’enfants ne sera pas pénalisée dans son chemin vers l’avenir par la vulnérabilité de ses parents, mais qu’elle bénéficiera d’un soutien pour accéder à toutes les opportunités disponibles, au même titre que ses pairs.
M de C : Selon vous, quels sont les avantages de l’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne ?
Linda Rama : Avant que l’Europe unie ne devienne une réalité, il y avait le rêve qu’un jour, sous le même ciel et sur la même terre, il y aurait un drapeau. C’est ce rêve des pères fondateurs et le rêve de leurs nations pour la paix, l’unité et le bien-être qui ont donné naissance au projet de l’Union européenne.
Nous, Albanais, nous avons le ciel, nous avons la terre, mais nous n’avons toujours pas le drapeau de l’Europe. Le rêve de posséder ce drapeau est peut-être le seul qui n’ait jamais faibli au cours de ces trois décennies et demie extrêmement difficiles, malgré le passage du temps et le changement de générations. Le fait que l’Albanie appartienne à l’Europe reste profondément ancré dans notre conscience collective. Et nous, Albanais, savons mieux que quiconque ce que signifie ne pas avoir cette affiliation. Nous avons essayé plus que quiconque, lorsque nous ne l’avions pas, pendant un demi-siècle de dictature communiste et d’isolement, et en 1990, pour la première fois de notre histoire, nous avons choisi l’Europe nous-mêmes et librement comme notre destin lorsque nous avons crié contre la dictature « nous aimons l’Albanie comme toute l’Europe ».
C’est pourquoi, pour nous, Albanais, l’Union européenne n’est pas une vache à lait, mais un pays comme celui imaginé par les fondateurs européens lorsqu’ils ont rêvé du projet politique le plus extraordinaire de l’histoire du monde.

M de C : L’Albanie est-elle en bonne voie pour rejoindre l’Union européenne ?
Linda Rama : C’est une question d’appartenance et d’aspirations. Nous parlons beaucoup d’appartenance, nous appartenons en effet à l’Europe, et donc, prendre cette notion d’appartenance à l’Europe et la développer, vous savez, comme une philosophie, pour des pays comme le nôtre, est très important. Nous sommes un pays qui n’a jamais contesté son appartenance à l’Europe, et cela ne devrait pas être considéré comme acquis par des pays comme le nôtre. Je ne pense pas que tous les pays des Balkans soient identiques à cet égard. Nous sommes Européens et nous faisons tout notre possible pour atteindre un niveau d’intégration satisfaisant du point de vue de l’appartenance. Car, du point de vue des aspirations, nous y sommes déjà !
Lire aussi > Nicolas Dufourcq – Bpifrance : “Nous n’avons jamais accordé autant d’aide à l’innovation qu’en 2023”
Photo à la Une : Portrait de Linda Rama